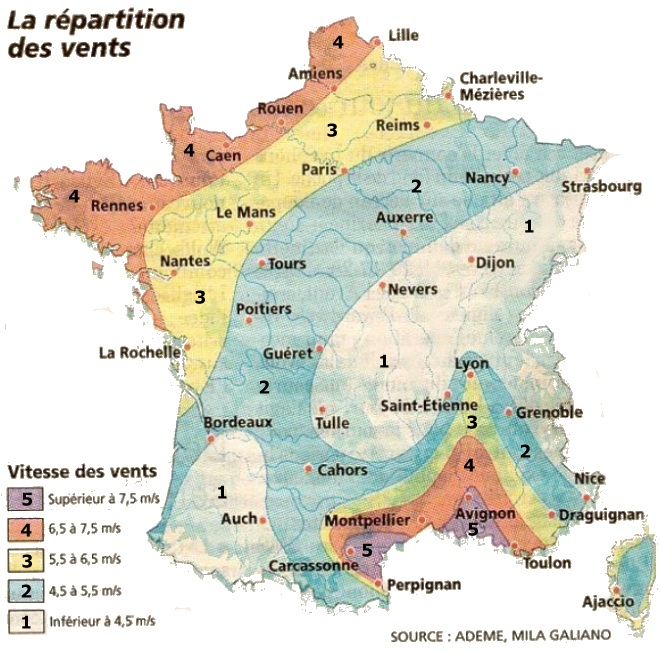Retour Pigne au Net n° 36
L'énergie
éolienne
par Serge Degueil
1.
L’Énergie Éolienne
C’est
l’énergie tirée du vent au moyen d’un dispositif spécifique. Pendant des
siècles, les moulins à vent ont fourni un travail mécanique utilisé pour faire
tourner la meule à moudre le grain, pomper l’eau pour l’irrigation, actionner
les scieries etc. Une des utilisations les plus typiques a été l’assèchement des
polders hollandais. Maintenant l’énergie éolienne s’oriente plus vers la
production d’électricité, ce qui élargit le domaine d’application de ce type
d’énergie mais demande une production permanente.
|
2. Principe de
fonctionnement et organisation
L’hélice fait tourner un générateur
électrique par l’intermédiaire d’un multiplicateur de vitesse. La
puissance d’une éolienne est fonction de la surface balayée par l’hélice
et de la vitesse du vent. Pour produire le maximum d’énergie, les
éoliennes doivent être en permanence face au vent ce qui est réalisé
soit par un gouvernail situé à l’arrière, soit par un « servomoteur »
commandé par une petite girouette donnant la direction de vent.
On distingue deux types d’éoliennes : les
petites éoliennes, jusqu’à quelques KW pour l’électrification de sites
isolés, et les éoliennes de puissance de plusieurs MW qui sont en
général regroupées en batteries et raccordées au réseau électrique.
Or une éolienne ne fonctionne que lorsque
le vent souffle. Il est actuellement très difficile et excessivement
coûteux de stocker l’électricité. |
 |
|
Un aérogénérateur ne peut donc être
utilisé comme seule source d’énergie. Il faut prévoir une autre source
d’énergie qui, pour les éoliennes isolées, est en général un générateur
du type groupe électrogène. Les éoliennes de puissance sont en général
regroupées dans des parcs d’éoliennes et reliées au réseau électrique.
Ceci présente l’avantage de réduire la longueur des connexions et
d’assurer une bonne gestion de la puissance d’appoint fournie au réseau.
|
|
3. Performance et disponibilité
Les éoliennes modernes commencent à
fonctionner avec un vent de l’ordre de 10 km/h en dessous duquel il est
difficile d’assurer une bonne régulation. A partir de 40 km/h, la
vitesse de rotation est stabilisée pour pouvoir fournir un courant de
bonne qualité immédiatement utilisable. C’est particulièrement vrai pour
les éoliennes raccordées au réseau qui doivent fournir un courant avec
une fréquence constante quelle que soit la vitesse du vent. Ceci est
obtenu en régulant la vitesse de rotation grâce à l’orientation des
pales. Lorsque les vents atteignent une vitesse de 90 km/h, les pales
sont « mises en drapeau » pour éviter la destruction de la machine. En
effet, à grande vitesse, le phénomène de précession gyroscopique crée
des contraintes pouvant entraîner des dégâts sur les pales et les
mécanismes.
Afin de récupérer le maximum d’énergie il
faut :
- avoir la plus grande surface possible
balayée par l’hélice. Le diamètre des hélices des machines de puissance
est fréquemment compris entre 30 et 60 m ; |
|
- situer les machines dans les endroits
venteux (bord de mer, sommet de collines, les couloirs venteux pour
bénéficier de l’effet venturi) ; la puissance est proportionnelle au
cube de la vitesse du vent,
- situer les hélices en haut d’un mât de
façon à s’affranchir de l’effet de freinage du vent au niveau du sol
(plus de 120 m pour les grosses machines).
Les sites éoliens intéressants en France
sont d’abord la façade ouest des côtes de la Manche et de l’Atlantique
soumise aux vents d’ouest forts et dominants, la vallée du Rhône avec le
Mistral et le Sud-Ouest de la côte méditerranéenne soumis à la
Tramontane. La carte des vents ci-dessous donne la répartition des vents
sur l’ensemble du pays.
Suivant la loi de Betz, une éolienne ne
peut récupérer que 60 % de l’énergie reçue. De plus, si on prend en
compte l’irrégularité du vent en intensité et en direction, on peut
considérer que le rendement est compris entre 12 et 30 % de l’énergie
initiale du vent.
L’amélioration de la technologie permet
maintenant de construire des aérogénérateurs de plus de 1 MW, le record
étant de 6 MW pour la machine E112 de la société Enercon. Organisées en
parc éolien, ces machines doivent être espacées d’environ 200 m, aussi
la surface utilisée par le MW éolien est très importante par rapport à
celle occupée pour toutes les autres énergies, sauf le solaire
évidement. |
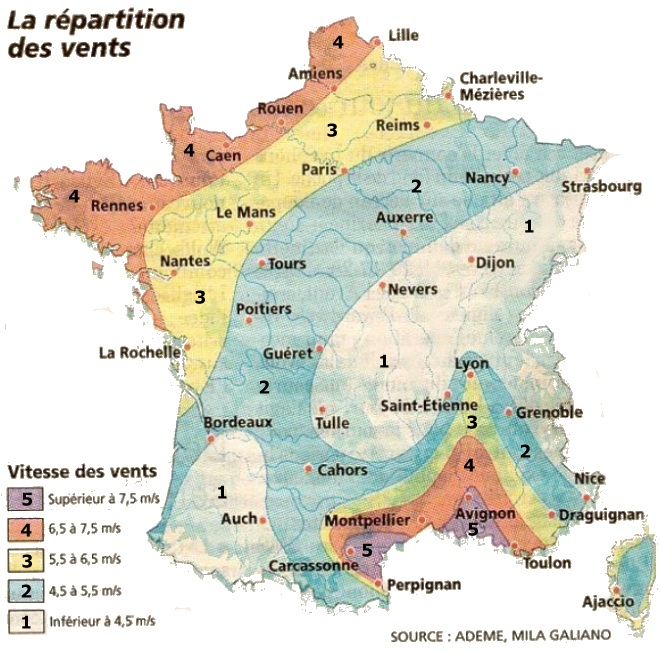 |
4. Problème de l’intermittence de la source d’énergie
On exprime souvent la disponibilité d’une machine
en « temps exploitable ». Les sources nombreuses situent ce chiffre entre 18 %
et 23 % en France, 18.3 aux USA, 20.6 à 23 % au Danemark et 20 % en Allemagne.
L’ADEME affiche une disponibilité de 28 %, ce qui est sans doute très optimiste.
En réalité, une machine tourne près de 70 % du temps mais à une puissance
inférieure à la puissance maximale, dite puissance installée. Pour simplifier le
propos on considèrera que la puissance moyenne globale de l’éolien correspond à
25 % de la puissance installée. Si l’on revient à la notion de « temps
exploitable », cela signifie que l’énergie globale fournie correspond à un
fonctionnement à pleine puissance pendant ¼ du temps seulement. Autrement dit,
sur une année une éolienne fonctionnera l’équivalent de 2 200 h. Pour une
puissance installée de 1MW on ne récupèrera donc que 2 200 MWh.
De plus, le vent souffle de façon très
intermittente, variable en durée et n’importe quand en heures, jours et saisons.
La disponibilité aléatoire de cette énergie est peu compatible avec la
disponibilité permanente que l’on exige de l’électricité. Il est donc nécessaire
d’avoir un ajustement instantané production/consommation à l’aide de générateurs
annexes.
Pour les utilisateurs indépendants ou les petits
réseaux autonomes, l’énergie est fournie par la source principale classique qui
fonctionnera les ¾ du temps, l’éolienne n’apportant qu’une énergie d’appoint. La
régulation est relativement aisée entre les deux sources.
Dans le cas de la connexion à un réseau de
puissance, le problème est plus complexe. À chaque instant (fraction de seconde)
l’énergie électrique fournie au réseau par les dizaines de générateurs des
centrales en service doit être strictement égale à l’énergie, fluctuant en
permanence, consommée par des centaines de millions d’appareils, lampes, moteurs
etc. L’énergie électrique consommée en France varie dans le rapport 1 à 2 entre
les moyennes d’été et d’hiver, dans le rapport 1 à 4 entre minuit au mois d’août
et 6 h du soir en décembre. Cela signifie qu’au moment des pointes de
consommation, lorsque l’on fait appel à toutes les disponibilités, on ne peut
plus compter sur l’énergie éolienne. Il est donc nécessaire de disposer d’une
capacité principale d’énergie couvrant l’ensemble de la demande, l’éolien ne
venant que comme source d’appoint permettant d’économiser les combustibles
fossiles et réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Cette
production électrique intermittente et aléatoire peut intervenir à des moments
où l’on n’en a pas besoin et contrairement à la plupart des autres sources
d’énergie l’énergie primaire, le vent n’est pas stockable. Seul le stockage
indirect est envisageable.
On peut citer par exemple :
- remonter de l’eau dans des réservoirs comme
c’est le cas actuellement avec les centrales électriques de montagne ;
- stocker l’énergie sous forme de gaz comprimé ;
- fabriquer de l’hydrogène par hydrolyse de l’eau
;
- stocker l’énergie sous forme électrochimique.
5. Influence des éoliennes sur l’environnement
Ce problème est un sujet polémique entre les
partisans et détracteurs de l’éolien. Nous ne ferons ici que soulever le
problème sans traiter le fond. Il touche essentiellement 3 thèmes : l’aspect
esthétique et la dégradation du paysage, la santé et le bruit, l’impact sur la
faune et les oiseaux.
Il est incontestable qu’à puissance égale,
l’emprise au sol de l’éolien est considérable par rapport à la plupart des
autres sources d’énergie (50 km² pour une puissance de 1300 MW qui n’est
disponible en moyenne que 25 % du temps). Ceci ne rend pas le sol inutilisable
sur l’aspect agricole mais le bruit généré peut avoir un impact sur la faune
locale avec perte de l’habitat pour certaines espèces. Il est bien sûr
souhaitable vis-à-vis de l’homme que les parcs éoliens soient situés loin des
habitations. Pour les installations individuelles ou les petites installations
locales, elles doivent respecter la législation sur les bruits sans doute plus
difficile à appliquer en milieu rural, caractérisé par son calme. Pour la vie
aviaire on constate effectivement quelques dégâts. Mais sont-ils plus importants
que ceux causés par les lignes électriques ? L’aspect esthétique et la
dégradation du paysage sont des problèmes très subjectifs laissés à
l’appréciation de chacun. Il est toutefois souhaitable de trouver le meilleur
compromis entre les endroits énergétiquement rentables et les zones de moindre
intérêt sur le plan du patrimoine.
6. Les nouveaux concepts
Devant le rendement modeste de ce type de
machine, les recherches sur l’amélioration des performances se poursuivent. Deux
nouveaux concepts semblent être porteurs de progrès : les éoliennes à effet
Magnus et les éoliennes carénées développées par la société Stormblade. Le but
de ces nouvelles machines est d’élargir la plage de fonctionnement pour tendre
vers un rendement de 30 %. On trouvera, si on le souhaite, dans l’encart en
grisé ci-dessous, quelques détails sur le fonctionnement et les avantages de ces
différentes machines.
L’effet Magnus a été découvert par Heinrich
Gustav Magnus (1802-1870), physicien allemand. Ce n’est rien d’autre que
l’effet que l’on donne à une balle de tennis ou un ballon de football lors
de la frappe. En plaçant un cylindre en rotation dans un flux d'air il se
crée une force induite, la portance, perpendiculaire à ce flux. Cette
portance est proportionnelle à la vitesse de rotation qu'on impose au
cylindre et à celle du vent d’où une maîtrise parfaite de la puissance
instantanée pour des vitesses de vent comprises entre de 30 et 100 km/h. Des
cylindres en rotation remplacent les pales. Leur vitesse de rotation est de
l’ordre de 3000 tours/mn. Ce projet ne s’applique pour le moment qu’aux
éoliennes de petite puissance et les avantages demandent à être évalués (système
développé par Mekaro Akita Co au
Japon et « Projet étudiant » de génie physique financé par EDF et ANVAR).
La « Stormblade turbine » est basée sur le
principe de la turbine du moteur à réaction ce qui permet d'augmenter la
vitesse de rotation du rotor sans avoir à subir le phénomène de précession
gyroscopique et de dépasser ainsi la limite physique de la loi de Beltz. La
plage de vitesse des vents utilisables pourra ainsi doubler, de 11km/h à
193km/h, ce qui présente l’avantage d’avoir une production d’électricité
plus continue et une puissance maximale plus élevée puisque celle-ci est
proportionnelle au cube de la vitesse du vent. Par contre, la puissance
produite est aussi proportionnelle à la surface balayée par les pales et
globalement la puissance délivrée reste inférieure à celles des éoliennes
conventionnelles. L’avantage demeure sa production plus régulière ; les
tests sur prototype donnent un rapport d’efficacité voisin de 3 par rapport
aux éoliennes à pales.
7. Coût d’une
installation et rentabilité
Le prix de revient du kWh éolien est fonction de
trois facteurs :
- l’investissement initial ;
- la fiabilité et la durée de vie de l’équipement
;
- fréquence des vents là où se trouve installée
l’éolienne.
Actuellement l’investissement initial est de
l’ordre de 1000 à 1300 € par kWh installé. Il englobe le coût des études, des
matériels, du raccordement, de l’installation, des frais de mise en route, soit
plus d’un million d’euros pour l’installation d’un mégawatt. Ce prix ne pourra
que baisser avec le développement de cette filière. Les différents constructeurs
donnent actuellement une durée de vie de 15 ans avec changement des pales à
mi-durée de vie. Pour l’installateur la rentabilité repose sur le prix de vente
du kWh. Actuellement le prix de revient du kW éolien est deux fois plus élevé
que celui du kW nucléaire et, pour satisfaire aux impératifs européens sur les
énergies renouvelables, EDF est dans l’obligation de racheter aux producteurs
l’électricité éolienne à des tarifs très avantageux. On trouvera ci-dessous
quelques estimations sur la base 2005/2006 :
8. Intérêt et limitation de l’éolien
Le
tableau ci-dessous donne la répartition de la production électrique
française en 2005 (source RTE).
|
|
Fossiles |
Hydraulique |
Éolien |
Nucléaire |
Total |
|
TWh(*) |
59 |
56 |
4 |
430 |
549 |
|
% |
10.7 |
10.2 |
0,7 |
78.3 |
100 |
Pour une capacité totale de 549 TWh, l’objectif
de 20 % d’énergie renouvelable correspond à 110 TWh. La production actuellement
d’énergie renouvelable étant de 60 TWh, il reste 50 TWh à réaliser, soit 5,7 GWe.
Si l’on fait porter cette charge énergétique uniquement à des éoliennes, il
faudrait de l’ordre de 23 000 machines de 1 MW pour avoir une production
permanente en prenant pour hypothèse qu’elles seront bien réparties sur le
territoire. Pour situer le problème, si on disposait une machine tous les 200 m
le long de la côte, le parc éolien s’étendrait sur une longueur de 4 600km. Ces
quelques valeurs montrent que l’objectif de 20 % d’énergie renouvelable sera
difficile à satisfaire, sachant que l’apport du photovoltaïque restera
négligeable et que la capacité de l’hydroélectrique est pratiquement saturée.
Ceci dit, le programme éolien pourra avoir un
rôle important dans la réduction d’émission des gaz à effet de serre en
réduisant les périodes de fonctionnement des centrales à flammes. Celles-ci
devront tout de même rester en veille active de façon à être mises rapidement en
route en cas de besoin. Lorsqu’il y aura excédent d’électricité, le surplus
pourrait servir, par exemple, à la fabrication d’hydrogène par électrolyse de
l’eau. Ce gaz, utilisé dans les moteurs thermiques, transports, groupes
électrogènes, piles à combustible etc., sera un facteur supplémentaire dans la
réduction des gaz à effet de serre. Par contre, le remplacement du nucléaire par
l’éolien n’est pas une bonne perspective car les centrales nucléaires ne peuvent
être mises en veille active. Ceci nécessitera alors la réalisation d’une
puissance quasi équivalente à l’aide de centrales à flammes pour palier l’aspect
l’aléatoire du vent.
Comme pour le photovoltaïque, l’énergie éolienne,
associée à un groupe électrogène ou une centrale thermique, trouve tout son
intérêt dans l’alimentation en électricité des régions isolées et en particulier
des îles qui sont en général bien ventées.
(*) 1 TWh = 1 TéraWattheure = 1 Milliard de kWh